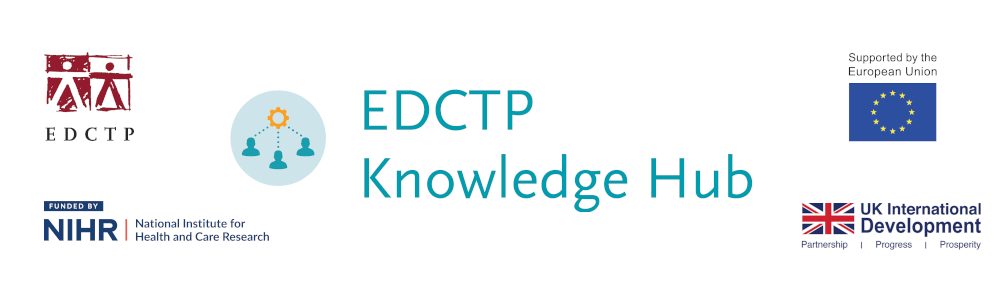
Consultez les étapes clés du processus en sélectionnant les boutons ci-dessous
Identifier les questions hautement prioritaires dans un contexte donné
Comprendre le contexte politique et impliquer les parties prenantes afin de définir les questions hautement prioritaires et pertinentes
Les résultats de l'exercice d'identification ne correspondent pas toujours directement aux décisions finales prises par les gouvernements ou les organisations quant aux recherches à mener, mais ils peuvent être utiles pour orienter ces décisions[1].
La recherche est l'étude détaillée d'un sujet dans le but de découvrir des informations ou de parvenir à une nouvelle compréhension[2].
Une preuve est « l'ensemble des faits ou des informations disponibles indiquant si une conviction ou une affirmation est vraie ou valide » [2].
Dans le domaine de la gestion des urgences sanitaires et des risques de catastrophe (HEDRM), la définition des priorités peut être effectuée au niveau du groupe de recherche qui tente d'élaborer une question de recherche spécifique, ou au niveau organisationnel, par exemple au sein d'une organisation non gouvernementale ou gouvernementale ou d'une agence des Nations Unies (ONU) qui tente de développer un domaine de recherche plus large, qui pourrait ensuite être affiné pour aboutir à une ou plusieurs questions de recherche spécifiques[1].
Lors de l’élaboration de la question de recherche, il est important de déterminer si l'outil sélectionné fournira des résultats à la fois fiables et valides. La conception de l'étude, les méthodes de population et d'échantillonnage, les objectifs de l'étude et les questions de recherche doivent tous guider le choix d'un outil de collecte de données [3].
Mener/identifier des recherches pertinentes pour les politiques
Utiliser des méthodologies appropriées pour collecter et analyser les données, en garantissant la qualité et la crédibilité de la recherche ; concevoir des solutions
Un certain degré de flexibilité peut être nécessaire pour répondre aux questions politiques importantes qui se posent, ce qui signifie que les priorités préétablies peuvent être modifiées pour tenir compte de la situation[1].
L'objectif d'un exercice de hiérarchisation des priorités de recherche dépend du contexte dans lequel il est mené, des processus politiques, sociaux et organisationnels qui ont conduit à son lancement et des gestionnaires, professionnels, praticiens, décideurs politiques et bénéficiaires finaux du processus (souvent appelés parties prenantes) [1].
Il n'existe pas de norme universelle concernant la portée ou la profondeur d'une priorité de recherche. Cependant, il existe un consensus sur divers éléments susceptibles de soutenir un exercice de hiérarchisation des priorités de recherche de qualité. Ces éléments peuvent être regroupés en trois étapes : les choses à faire avant l'exercice de hiérarchisation des priorités (préparation avant l'exercice), les choses à faire pendant l'exercice et les choses à faire après l'exercice[1].
La recherche qualitative explore les expériences et les interprétations subjectives des individus, à l'aide d'observations, d'entretiens et de méthodes connexes [4]. Contrairement à la recherche quantitative, qui se concentre sur des variables mesurables, la recherche qualitative s'appuie sur des données recueillies par le biais d'observations, d'entretiens et d'autres méthodes afin de fournir un aperçu des phénomènes humains complexes. Néanmoins, la crédibilité de la recherche qualitative peut être remise en question si le chercheur n'établit pas sa fiabilité[4].
Pour renforcer la crédibilité, les chercheurs qualitatifs ont généralement recours à des stratégies telles que la triangulation, la vérification par les membres, le débriefing par les pairs, la description dense, la réflexivité, la saturation et les audits externes[4].
Traduire les résultats de la recherche
Identifier les principaux résultats et élaborer des recommandations politiques concrètes
La crédibilité fait référence au degré de de fiabilité et d’exactitude des résultats de la recherche. Établir la crédibilité permet de se prémunir contre l'influence d'expériences, d'émotions et de perspectives subjectives qui peuvent obscurcir la véritable nature d'un sujet de recherche[4].
Des informations fiables sont essentielles pour tirer des conclusions valables, et la fiabilité et la validité dépendent toutes deux d'une conception appropriée de l'étude et de mesures fiables, que l'approche soit qualitative, quantitative ou mixte. Des conceptions d'études imparfaites qui manquent de fiabilité et de validité démontrées compromettent inévitablement les résultats[3].
Lors de la traduction des résultats en recommandations, chaque affirmation doit être clairement liée à des preuves à l'appui ; lorsque des opinions plutôt que des preuves sont présentées, cela doit être explicitement indiqué. Enfin, la viabilité pratique de chaque recommandation doit être évaluée, en tenant compte des considérations de faisabilité et de mise en œuvre[5].
Diffuser les résultats de la recherche
Définir les buts et objectifs de l'initiative de diffusion/traduction
Déterminer le contenu à diffuser
Envisager différentes options ou différents mécanismes de communication
Il est essentiel de comprendre le contexte pour traduire les preuves et les recherches en pratique. Cela peut être réalisé en :
- Adaptant le mode de diffusion aux utilisateurs visés par les données probantes.
- Adaptant l'application des résultats aux besoins, aux ressources et aux contraintes locaux[2].
En comprenant l'importance de la crédibilité, vous pouvez vous assurer que les données sont fiables, que les résultats sont fiables et que les conclusions sont valables[4].
La fiabilité fait référence à la cohérence des résultats dans le temps[3]. Par exemple, un pluviomètre mesure les précipitations, la pluie, et un baromètre mesure la pression atmosphérique, ce qui permet d'établir des prévisions météorologiques. Des instruments défectueux donneront des mesures peu fiables. Le même principe s'applique également à la recherche : si les outils de collecte de données manquent de fiabilité, ils ne peuvent pas fournir les informations nécessaires. La conception de l'étude et les méthodes de collecte de données doivent donc produire des résultats précis et cohérents lorsqu'elles sont répétées dans le temps dans des conditions comparables[3].
Les notes d'orientation doivent être rédigées avec soin afin de produire des résultats exploitables. Elles doivent être rédigées dans un langage professionnel correct, avec un minimum de jargon technique, être concises, informatives et adaptées à un public préidentifié et ciblé[5].
Des notes d'orientation bien rédigées favorisent l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes et restent l'un des outils les plus importants pour aider les décideurs politiques[5].

Mettre en œuvre, suivre, évaluer et ajuster
Identifier et catégoriser les parties prenantes
Évaluer et améliorer les stratégies de diffusion/traduction
« La pratique sera définie comme « l'application ou l'utilisation effective d'une idée, d'une croyance ou d'une méthode, par opposition aux théories qui s'y rapportent »[2].
Il est essentiel d'établir la crédibilité dès le début de la recherche qualitative afin de garantir que les résultats soient considérés comme valables[4].
- Le fait d'aborder les problèmes potentiels tels que la partialité, le manque de clarté ou le manque de diversité dans la recherche qualitative renforce à la fois la crédibilité et la qualité globale du processus de recherche[4].
La crédibilité peut être obtenue en utilisant des méthodes appropriées de collecte et d'analyse des données, en garantissant la transparence et la clarté du processus de recherche et en employant des stratégies rigoureuses pour évaluer la qualité de la recherche[4].
Impliquer les décideurs politiques
Établir des relations avec les décideurs politiques, faciliter le dialogue et plaider en faveur de décisions fondées sur des preuves
S’assurer d'avoir préalablement identifié le public cible[5].
Indiquer clairement quelle politique actuelle vous souhaitez modifier[5].
Préparer le terrain en identifiant les lacunes de la politique actuelle. Où et pourquoi échoue-t-elle ? En quoi vos recommandations améliorent-elles le statu quo ?[5]
Prendre conscience de la manière dont les politiques sont élaborées : les acteurs politiques gouvernementaux donnent la priorité aux options qui sont pratiques, rentables et socialement acceptables[5].
Si vous suggérez un changement, précisez exactement ce qui doit changer, comment le changement se produira, quelles ressources sont nécessaires, d'où proviendront ces ressources et quels seront les avantages pour les décideurs politiques et la société en général. Si vos recommandations incluent ces éléments, elles ont beaucoup plus de chances d'aboutir au changement souhaité[5].
Le mot « réalisable » suggère que vos recommandations doivent être actives. Essayez d'utiliser un langage actif plutôt que passif, avec des mots tels que « utiliser », « engager », « intégrer », etc.[5].
Rédiger des recommandations politiques succinctes. Identifiez trois recommandations et développez-les. Choisissez les trois qui sont les plus pratiques et les plus pertinentes pour votre public cible, puis concentrez-vous sur leur présentation de la manière la plus claire et la plus concrète possible[5].
Soutenir la mise en œuvre des politiques
Aider à la mise en œuvre des politiques et surveiller leur impact
Anticiper et atténuer les obstacles potentiels
Il est important de comprendre les niveaux de contexte qui auront une incidence sur les données probantes mises en œuvre dans chaque cas spécifique. La mise en œuvre d'un même ensemble de recherches ou de données probantes peut produire des résultats différents aux niveaux micro, méso ou macro [2].
Le niveau micro concerne les besoins, les capacités et les flux de travail des praticiens de santé individuels ou des stagiaires. Le niveau méso se concentre sur la compréhension des besoins et des applications des systèmes ou des équipes, tandis que le niveau macro implique la compréhension des rôles des acteurs importants ou nationaux[2].
Les notes d'orientation sont conçues pour informer les décideurs des options politiques qui sont solides, fondées sur des données probantes et qui permettront d'obtenir les résultats souhaités dans divers scénarios. Pour obtenir les résultats les plus efficaces, il est plus efficient d'identifier les problèmes des décideurs politiques et de fournir des recommandations politiques spécifiques et réalisables [5].
La diffusion systématique et opportune d'informations, accompagnée d'un soutien à la formation professionnelle continue (FPC), est essentielle à l'application des directives pratiques à la pratique actuelle[2]. Une bonne compréhension du contexte est essentielle pour parvenir à cette diffusion systématique et opportune d'informations à ceux qui en ont besoin. Les professionnels de santé ou les stagiaires spécifiques sont plus susceptibles d'adopter des approches mûrement réfléchies s'ils savent qu'ils sont représentés dans le processus[2].
Évaluer et adapter
Évaluer en permanence l'impact de la politique et apporter les ajustements nécessaires en fonction des retours d’expérience et des nouvelles preuves
Il est important de comprendre les hypothèses liées à des méthodologies de recherche spécifiques et la manière dont ces hypothèses influencent la collecte, l'analyse et la représentation des données qui découlent de leur utilisation[2].
Il existe actuellement quatre grands paradigmes dans la recherche en matière d'enseignement médical. Les paradigmes sont des « ensembles de croyances et de pratiques, partagés par des communautés de chercheurs, qui régissent la recherche au sein des disciplines ». Les quatre paradigmes sont le positivisme, le post-positivisme, l'interprétativisme et la théorie critique. Chaque paradigme génère des informations précieuses, et aucun n'est intrinsèquement supérieur aux autres[2].
De nombreux facteurs influencent la transposition des données probantes dans la pratique. Parmi les plus importants, citons une définition claire des termes, la compréhension des paradigmes sous-jacents à la recherche menée, la compréhension du rôle du contexte, l'adéquation des approches au contexte, l'adoption d'une approche d'équipe et l'adhésion des parties prenantes[2].